Richard Dindo: A la recherche
du temps perdu
Visions
Si Max Frisch est pour Richard Dindo (1944-2025) une figure paternelle, Rimbaud est un frère. Dans cet entretien, le documentariste explique la place du poète rebelle dans sa vie, auquel il a consacré un film magnifique: Arthur Rimbaud, une biographie (1991). Il raconte également en quoi le cinéma est son utopie, sa manière de survivre sur les ruines de l’histoire politique. Il explique les ressorts de sa création: le mythe, la parole, la mémoire créatrice, l’«émouvance», l’enquête, le montage comme «esthétique de l’intelligence»…
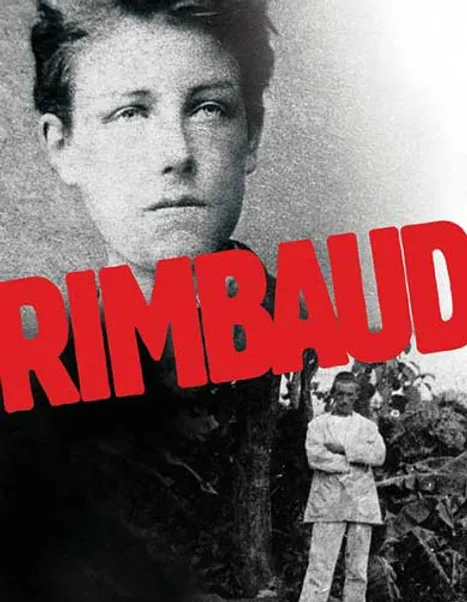
Comment êtes-vous venu à cette «biographie» de Rimbaud?
Depuis très longtemps, avant même que je fasse du cinéma, j’avais en tête deux projets de films, sur deux hommes clés de mon univers personnel: Max Frisch qui est pour moi une figure paternelle, et Arthur Rimbaud qui est une figure fraternelle. Il y a dix ans, j’ai pensé que je ferais le film sur Rimbaud en 1991, pour le centième anniversaire de sa mort, parce que ce serait sans doute plus facile de le financer.
Au-delà de la mort de l’utopie politique
En quoi Rimbaud est-il une «figure fraternelle»?
Rimbaud est pour moi la métaphore de la nécessité de la rébellion, mais en même temps de son échec permanent, de la destruction inéluctable de toute utopie. Il est en cela d’une actualité brûlante, un frère des jeunes Zurichois – victimes de la brutalité policière – de mon film précédent, Dani, Michi, Renato & Max. Jamais les jeunes n’ont eu aussi peu d’espoir, de possibilité de construire un monde nouveau et différent. Voilà pourquoi j’ai mis la Commune de Paris au centre du film. A l’instar de la guerre d’Espagne, c’est une défaite qui m’a marqué comme si je l’avais vécue personnellement.
Frère dans la rébellion, je vois bien. Mais êtes-vous aussi frère de Rimbaud dans l’échec?
Un ami m’a dit un jour que j’étais amoureux de la défaite. C’est faux: je vis seulement dans l’ombre et avec la conscience politique de l’échec. Faire des films, c’est pour moi aussi faire le travail de deuil de cette défaite, de la mort de l’utopie. Le cinéma est ma manière de survivre en restant libre et créatif, sans tomber dans l’amertume. Je ne crois plus qu’au cinéma. Mon utopie est le cinéma.
Frisch le père, Rimbaud le frère: on est en plein roman de famille.
Je suis un enfant de mai 1968. Marx et Freud ont été mes guides et mes formateurs. J’ai toujours travaillé sur des structures familiales. Dans Rimbaud, comme dans mes autres films, je raconte toujours les origines.
Roman de famille, mais toujours habité par un grand absent : le père.
Ma vie, c’est vrai, est dominée par l’absence du père. Mon cinéma est littéralement, au sens psychanalytique du terme, mon propre roman de famille. Avec chaque film, je reconstitue une famille dont je suis en même temps le fils et le père.
Max Frisch n’a-t-il pas justement, à sa manière, comblé cette absence du père?
A vingt ans, ne supportant plus la Suisse, je suis parti à l’étranger, faire un voyage en Orient, en auto-stop. Sur moi, j’avais toujours les livres de Frisch. C’est en le lisant, à travers son écriture et sa pensée, qui étaient suisses et dans lesquelles je me reconnaissais parfaitement, que j’ai peu à peu découvert mon identité. Cela dit, à aucun moment je n’ai eu envie de remplacer le père absent par un autre père. Je préférais vivre dans la métaphore du père absent, créer cette métaphore à travers un père fictif, fictionnel. Cela explique, de facto, l’absence de Frisch dans mon film Max Frisch, Journal I-III (1981)
Il est vrai que dans vos films, qui traitent d’ailleurs souvent du passé, le personnage central est fréquemment absent.
J’avais, pendant le tournage, filmé Frisch une ou deux fois, mais j’ai immédiatement senti que je perdais ma liberté par rapport à lui. C’était comme si je n’avais pas envie de me soumettre à lui, comme si je n’avais même pas envie qu’il existe. En revanche, je ressentais le besoin de vivre, de me fonder à travers son absence. Je ne l’ai donc pas filmé; quand il apparaît sur l’écran, ce sont toujours des photos ou des documents d’archives. Cela va au point que des gens, en France, ont cru en voyant le film que Frisch était déjà mort. Oui, l’absence du personnage central est un principe essentiel de mon cinéma. C’est elle aussi qui me permet de reconstituer le temps perdu…
La reconstitution d’une vie
On arrive ici gentiment à Proust. Le fondement de votre écriture cinématographique?
L’homme qui m’a le plus influencé est incontestablement Proust. D’une certaine manière, dans mon existence et mon cinéma, je suis plus proustien que rimbaldien. La biographie pour moi est toujours une recherche du temps perdu; elle s’élabore à travers une écriture qui est la reconstitution d’une vie. Le monde n’est intéressant que par la mémoire des êtres humains, de même que l’être humain n’est intéressant que par sa parole. Aller à la recherche du temps perdu, c’est rechercher des traces. Mais ce faisant, c’est aussi créer de nouvelles traces, un récit de traces qui devient lui-même objet de mémoire.
Vous parlez de reconstitution…
Toute existence se mémorise à travers le temps. On ne peut saisir ni l’instant ni le temps. Le temps n’existe que reconstitué, à travers la mémoire. Il est donc toujours mémoire, une mémoire qu’il faut reconstituer comme la fiction. Pour moi, la mémoire et la fiction, c’est la même chose. Proust l’a dit: créer une œuvre d’art, c’est arrêter le temps pour rendre l’instant éternel. Par la spécificité de son langage, qui est de l’ordre de la reconstitution du temps, le cinéma crée une vérité qu’il est le seul à pouvoir exprimer. A la fin du film, Max Frisch m’a dit que j’étais la personne qui le connaissait le mieux. Il avait senti que j’avais touché au cœur de sa vérité, à quelque chose que seul le cinéma pouvait exprimer. De la même manière, je pense avoir touché la vérité profonde de Rimbaud.
Cette quête du temps perdu passe dans votre cinéma par un travail sur le lieu…
C’est la source de ce que j’appelle l’«émouvance». J’ai toujours vécu dans la fascination des lieux réels. Être à un carrefour en Espagne, en sachant qu’un combattant y est mort pendant la guerre civile, rend ce lieu émouvant. La connaissance de la mémoire qui habite un lieu transforme non seulement ma présence en ce lieu, mais aussi l’image que je peux en faire. Voilà pourquoi, en m’attaquant à Rimbaud, il me fallait aller en Afrique. Cela peut sembler bête et naïf, mais être à Harar en sachant que Rimbaud y a vécu est pour moi source d’une grande émotion.
Vous y faites, d’ailleurs des plans particuliers, très distants, objectifs.
Quelqu’un m’a reproché d’avoir fait des plans où l’on ne voit pas les gens. J’ai cherché à filmer la vie d’époque à travers des plans d’époque, larges et neutres. C’est une question de logique dramaturgique. Je ne suis pas allé à Harar pour filmer les gens, leur misère, leur réalité, mais pour faire des images du passé, filmer des traces de la mémoire de Rimbaud. Et ces images, je les ai voulues à distance, objectives, en plans généraux, proches des photographies de l’époque qui visaient moins à exprimer la subjectivité ou l’humanisme de leurs auteurs que la découverte émerveillée du monde.
La documentarisation du réel
Toute image, au moment même où elle est tournée, se transforme en document de soi-même. C’est ce que j’appelle la «documentarisation» du réel. Faire des images qui non seulement témoignent de ma présence au monde, à un moment et en un lieu précis, mais prouvent aussi cette chose à la fois si évidente et si mystérieuse: j’existe et le monde existe. Cinématographiquement, cette évidence est pour moi quelque chose de très émouvant. Faire du cinéma n’est pas seulement, comme le disait Cocteau, «filmer la mort au travail»; c’est, au-delà, ressusciter les morts à la vie.
Mais les lieux, pour vous, ce sont aussi les fenêtres, les escaliers, l’eau, le ciel, qui dans vos films reviennent comme autant de leitmotive musicaux, symboliques.
Quand je tourne un film, je ne me pose que deux questions: qui regarde? qui parle? Toute la mise en scène en découle. La fenêtre, pour moi, est une définition du regard, de même que chaque image est en elle-même la définition d’une fenêtre: un passage, une frontière qui est le lieu même du regard, un lien entre l’intérieur et l’extérieur, le présent et le passé, la parole et la mémoire. Cela a commencé avec Des Suisses dans la guerre d’Espagne (1973). Dans chaque entretien, il y a une fenêtre dans le plan. Derrière eux, il y a le réel, un regard sur ce réel. Une manière de mettre ces hommes en rapport avec la réalité suisse, avec la mémoire et l’histoire de ce pays dont ils avaient été exclus.
Si les lieux jouent un rôle important dans cette alchimie du cinéma et de la mémoire, quel est le rôle de la parole?
J’ai toujours été fasciné par la parole, par l’être qui se crée à travers sa parole. La parole est vie, résurrection. Elle est toujours et à tout instant un acte de libération, révolutionnaire. Si Rimbaud m’a tant passionné, c’est parce qu’il est allé au bout du langage, de la rébellion dans le lyrisme et la poésie. Il est, en cela, au cœur de la culture à laquelle j’adhère: la résistance qui passe aussi par le langage. J’aime, au cinéma, donner la parole aux autres, à ceux qui ne l’ont jamais eue ou à ceux qui, comme Rimbaud, l’ont utilisée à travers une révolte. J’aime les gens à travers leur langage. Rendre la parole à quelqu’un est lui rendre sa dignité. C’est donc, toujours, aussi une entreprise politique.
Mythe et démystification
Mais, chez vous, la parole est aussi mythique.
Dans la mesure où le mythe n’existe que raconté, tout récit est toujours de l’ordre du mythe, et au centre du mythe il y a l’absence. Mon cinéma, qui est un art de la survivance, est habité par le mythe de l’absent, de l’absence racontée par les survivants.
C’est caractéristique dans Rimbaud.
J’ai essayé de revenir au point zéro du mythe Rimbaud, de le déconstruire, de le désacraliser à travers la parole de ceux qui, objectivement, par leurs récits, l’avaient créé: sa sœur, sa mère, Verlaine. À travers ce processus, le film révèle le terrible échec de Rimbaud que le mythe du poète dissimule. J’ai refait de Rimbaud un être humain, quelqu’un qui a vécu tragiquement, qui est mort après s’être complètement renié, après avoir trahi sa poésie en redevenant l’esclave de son passé, de ses origines, de sa famille. Mon roman familial, c’est aussi cela: la haine de la famille, le refoulement des origines.
Cette démystification passe dans le film par une confrontation entre deux régimes de paroles, deux types d’images.
Comme dans Max Haufler, il y a deux films en un. Le film raconte deux fois la vie de Rimbaud, une fois de l’extérieur, à travers le regard et la parole des gens qui l’ont le mieux connu. Une autre fois de l’intérieur, à travers le regard et les textes de Rimbaud lui-même, que j’ai choisis en fonction de leur caractère insurrectionnel, autobiographique et immédiatement compréhensible.
Divers régimes d’image
Pourquoi les images vidéo?
Pour avoir la pleine liberté de chercher des images, mais aussi pour avoir un contrôle permanent sur ces images (à travers un moniteur). Dès le départ, il était clair que je ferais des images vidéo, qui représenteraient le regard de Rimbaud, qui seraient le lieu d’où il parle et d’où il regarde, et qui se différencieraient des autres images.
Ces images ont aussi une lumière particulière…
J’ai tout le temps cherché à filmer la lumière. Si j’ai très vite eu le sentiment que je trouverais plus facilement ces images en vidéo, j’étais sûr aussi quelles seraient plus lumineuses qu’en un autre format. En 16mm, une fois gonflées, on n’aurait plus vu la différence avec le 35mm. En super-8, en revanche, on n’aurait pas eu la même lumière; cela aurait été plus sombre, plus plat.
Il y a aussi, dans ces images vidéo, un lyrisme qui fait penser à la fin de Dani, Michi, Renato & Max.
La vidéo, c’est le regard de Rimbaud. Je ne cherche jamais à faire de la poésie, à être poétique à tout prix. Comme disait Godard à propos de Rossellini: «Un plan n’est pas juste à force d’être beau, il est beau à force d’être juste.» La poésie, le lyrisme viennent de l’objet lui-même. Il se trouve que je suis en face de quelque chose de très poétique, de très beau: les phrases de Rimbaud que je dois «illustrer». Avec quelles images montrer le monologue intérieur de Rimbaud? Telle est la question qui s’est posée.
J’ai l’impression que, porteur de la parole, l’acteur est pour vous moins un corps dans un espace qu’une voix et un regard.
Ce qui m’intéresse est l’approfondissement de la notion de biographie au cinéma. Or cela n’implique justement pas le corps, mais la parole. Je ne crois pas qu’on raconte une biographie à travers un corps. Cela d’autant moins quand le personnage central est absent, quand son corps est déjà mort. Si j’aime beaucoup le cinéma américain pour son savoir-faire, sa mobilité et son intelligence pratique, en revanche sa manière de jouer sans arrêt sur le corps, de faire croire que le corps est vraiment vivant et qu’on est dans le réel quand l’acteur bouge et fait énormément de choses, relève pour moi d’un «activisme» trompeur. Il est avant tout de l’ordre du calcul: moins un effet de réalité qu’un effet de jeu.
Comme Bresson, je refuse le théâtre filmé. De toute manière, je ne cherche pas à faire de la fiction comme les autres, je cherche ma propre fiction et cette quête ne passe pas par le jeu des acteurs. Cela dit, il y a dans mes films une volonté de formalisation qui passe aussi par la présence du corps. Pour moi, un être qui parle est, en soi et sans qu’on ait besoin d’une action pour y croire, un magnifique spectacle. La voix, ici, est essentielle. Avec les lieux, elle est la source de l’«émouvance», la vraie musique de mes films.
Au fond, vous opérez une forme de renversement de la perspective classique. À la limite, les personnages deviennent acteurs.
Exactement. Dans Dani, Michi, Renato et Max par exemple, tous les personnages sont des acteurs qui jouent leur propre destin. Dès qu’on parle, dès qu’on est devant la caméra, on joue quelque chose. J’ai toujours considéré mes personnages réels comme des acteurs.
Débordement vers la fiction
On a, à propos de vos films, parlé de «mélange» de fiction et de documentaire. Cette expression vous satisfait- elle?
Je préfère le terme de «débordement» du territoire documentaire vers la fiction. Or, aller vers la fiction, c’est atteindre la dimension imaginaire. Sur un écran, un acteur ou un personnage n’est plus qu’une image. Ce qu’on y voit est toujours un objet créé, artificiellement, volontairement. Dans mes films, il y a une très forte volonté de construction. Or, dans la mesure où il est construit, tout film est un objet fictionnel, une fiction.
Quel est le rôle des acteurs dans ce débordement?
D’abord, je ne crois pas que la fiction ait quelque chose à voir avec des acteurs. C’est quelque chose de créé, de construit, qui se fait image par image. Si j’ai travaillé dans Rimbaud avec des acteurs, c’est uniquement parce que les personnages réels étaient morts. Et comme j’avais besoin de les faire parler, il me fallait des comédiens.
Comment, alors, définiriez-vous le documentaire?
Je n’invente jamais d’histoire. Tout ce que je raconte s’est toujours réellement passé jusqu’au plus petit détail. Je pars toujours du réel, d’une matière première. Le monde est toujours déjà là. Le documentaire se définit d’abord par le sujet. A mon avis, le seul problème est de ne pas rester prisonnier de ce sujet, de le faire éclater en lui opposant ma liberté de créateur. Pour cela, il faut une forme, suffisamment forte pour qu’elle s’impose au sujet. Autrement dit, la matière est réelle, mais tout dépend de ce que tu en fais, de la manière dont tu la travailles formellement, dont tu la transformes créativement. Le documentaire ne m’intéresse que s’il déborde vers la fiction.
Cette formalisation passe chez vous par l’enquête.
L’enquête a, pour moi, une dimension formelle. Objectivement, elle constitue le moteur de mes films, ce qui les fait avancer, permet de les structurer. Mais en même temps, elle n’est qu’un prétexte pour aller à la recherche d’images et de sons, à la recherche du film lui-même.
Eléments de l’enquête, les entretiens dans Rimbaud, mais aussi dans vos autres films, sont très particuliers.
Ce sont vraiment ce que j’appelle des monologues ininterrompus par étapes. L’acteur s’adresse directement au public et non à moi, cinéaste. C’est une enquête fictive…
L’esthétique de l’intelligence
Et le montage?
C’est l’«esthétique de l’intelligence» dont parle Bachelard. Si j’essaie de créer un film en train de se faire, dans lequel des témoins créent un mythe à travers le récit de l’absent, le montage n’est autre que la manière de montrer, image par image, comment ce film et ce mythe se construisent. Le but de mon cinéma est là: rendre le spectateur témoin de la construction d’un mythe ou d’un récit à travers la création d’un film.
Quelle est, exactement, la place de l’auteur dans ce débordement?
Mon cinéma demande au spectateur de recréer en permanence le film que je suis en train de faire. Ce processus est le produit du montage, qui cherche à montrer au maximum le réel de mon sujet sans que je sois moi, cinéaste, trop présent au niveau de l’interprétation des choses. J’essaie de faire en sorte que la matière du film s’exprime par elle-même; le film est réussi quand, grâce au montage, il atteint une cohérence et une logique telles, en tant qu’œuvre d’art et objet fictionnel, que le spectateur a l’illusion qu’il s’est construit de lui-même, sans ma volonté. J’essaie de disparaître dans le sujet, dans les personnages. Chaque personnage dit ce que j’ai envie de dire et d’entendre, ou ce que j’aurais pu dire moi-même. Ma présence est dans la structure, dans la construction du film. Je n’ai pas envie d’être autrement présent.
Le montage est chez vous plus important que le tournage…
Pour dire la vérité, le tournage est pour moi souvent une corvée. Je préfère de loin le montage. Je suis un cinéaste qui crée avant tout une structure, une dramaturgie. A la limite, mon idéal serait de faire tourner les images par d’autres et de les monter à ma manière. Mon plaisir de cinéaste, c’est le montage; seul face à ma table de montage, à travailler sur les images, les voix, les rythmes et la musicalité du film.
Tout cinéaste a, consciemment ou non, certains maîtres. Y a-t-il des cinéastes qui vous ont particulièrement influencé ?
Il m’est difficile de parler d’influences. Quand on est derrière une caméra, on ne pense à plus rien d’autre. J’aime comme tout le monde des cinéastes comme Renoir, Rossellini, Welles, Ozu, Dreyer, Bresson ou Godard. Mais trois m’ont particulièrement marqué: Jean-Marie Straub au niveau des images, du plan et de la précision du regard; Alfred Hitchcock au niveau de la structure; John Ford, enfin, pour les sentiments et l’émotion.